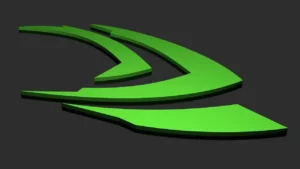Mobilité : la voiture reste en tête, mais les transports en commun gagnent du terrain
Les politiques publiques tournent la page de l’autosolisme
Dans les métropoles, le vent semble tourner. Depuis plusieurs années, les autorités locales mettent en œuvre des politiques ambitieuses pour limiter la place de la voiture en ville. L’objectif est clair : améliorer la qualité de vie des habitants, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et fluidifier les déplacements urbains. Pour ce faire, les pouvoirs publics investissent massivement dans le développement des transports en commun : nouveaux trams, prolongement de lignes de métro, amélioration des fréquences de bus, renouvellement des flottes avec des véhicules électriques ou hybrides, création de pôles d’échange multimodaux, etc.
Parallèlement, des mesures plus contraignantes sont mises en place pour décourager l’usage de la voiture individuelle. Zones à faibles émissions (ZFE), augmentation du prix du stationnement, piétonnisation de certaines rues, réduction des voies de circulation au profit des pistes cyclables… toutes ces décisions participent d’une volonté de rééquilibrage de l’espace public, longtemps dominé par l’automobile.
Si ces politiques rencontrent parfois des oppositions – notamment de la part de certains commerçants ou habitants dépendants de la voiture – elles semblent néanmoins produire des effets concrets. Les habitudes évoluent, lentement mais sûrement, sous l’effet conjugué des incitations et des restrictions.
Une jeunesse urbaine en quête d’alternatives
Les premiers à s’approprier ces nouveaux modes de déplacement sont, sans surprise, les jeunes urbains. Moins enclins à posséder une voiture, plus sensibles aux questions écologiques, habitués à la flexibilité offerte par les applications de mobilité, ils adoptent volontiers les transports collectifs. Pour eux, le bus ou le métro ne sont pas perçus comme une contrainte, mais comme une option pratique, économique et responsable. L’abonnement mensuel aux transports en commun est souvent préféré au crédit automobile, d’autant plus que le coût de possession d’une voiture ne cesse d’augmenter : carburant, assurances, entretien, parking… autant de dépenses que beaucoup souhaitent éviter.
Cette génération s’ouvre également à d’autres formes de mobilité : vélo, trottinette électrique, covoiturage, autopartage… Une diversité d’options qui permet d’adapter ses déplacements en fonction de ses besoins et de son budget. Les plateformes numériques ont joué un rôle clé dans cette évolution, en rendant l’accès à ces services simple et instantané.
Ce changement de mentalité ne concerne pas uniquement les jeunes. De plus en plus d’actifs, de familles et de seniors reconsidèrent leur rapport à la voiture, notamment dans les villes bien dotées en infrastructures alternatives. La mobilité partagée devient progressivement une norme, surtout dans un contexte où la transition écologique impose de repenser nos comportements.
Conclusion : vers une mobilité rééquilibrée
Le paysage de la mobilité est donc en pleine mutation. Si la voiture conserve une place importante, son règne sans partage est remis en question. À l’échelle des grandes agglomérations, le développement des transports en commun et des mobilités douces modifie en profondeur les usages et les mentalités. Ce mouvement reste progressif, mais les signes sont là : la mobilité urbaine devient plus variée, plus durable et plus adaptée aux enjeux de demain.
La réussite de cette transition dépendra toutefois de plusieurs facteurs : la qualité et la fiabilité des alternatives proposées, l’accessibilité pour tous, y compris en dehors des centres-villes, et l’accompagnement des citoyens dans ces changements. Si ces conditions sont réunies, il est probable que la voiture devienne un choix parmi d’autres, et non plus une nécessité.
À lire aussi
- Travaux SNCB à Bruxelles : trafic ferroviaire fortement perturbé les 7 et 8 mars entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord
- Au Sablon, le café Costermans se réinvente au fil des saisons
- « Marceline », un hymne à la vie à l’Auditorium Jacques Brel à Anderlecht
- Paroles de femmes au Théâtre national Wallonie Bruxelles
- Le groupe liégeois John Cockerill cherche un investisseur